En bref
Lors de la sortie du premier tome de Providence, je supposais qu'Alan Moore s'amuse de l'ambiguïté entre l'utilisation d'avatars et le référencement respectueux pour relever les éléments constitutifs de l'œuvre de H.P. Lovecraft en les opposant à des éléments étrangers. L'exemple le plus probant réside dans notre héros Robert Black, avatar de Robert Block, personnage au caractère typiquement Lovecraftien, celui du jeune instruit légèrement excentrique, mais qui porte pourtant un ''fardeau'' (d'époque, précisons) que n'aurait jamais pu concevoir Lovecraft : l'homosexualité. A la lecture de ce deuxième volume des mésaventures de Black, il m'apparaît évident que Moore refuse d'utiliser les acteurs per se de Lovecraft (contrairement à ce qu'il fait dans « La Ligue des Gentlemans Extraordinaires » avec Allan Quatermain, Mina Murray, Nemo ou Mister Hyde) et multiplie les avatars littéraires afin d'inscrire son récit dans une sorte d'itération Historique. La rencontre entre Robert Black et un jeune Howard P. Lovecraft témoigne directement d'une Histoire révisée, sorte de ''Et Si ?'' romanesque, où les figures fictives et réelles se croisent pour alimenter les ''Yog sothoteries'' futures de l'écrivain. Un ambitieux jeu de poupées russes tentaculaires se met alors en place, présentant une œuvre dans une œuvre dans une œuvre, etc. L'atout de l'écriture d'Alan Moore est d'imaginer l'ensemble de Providence comme une succession de récits complets (avec un début, un milieu et une fin). Si d'aucuns considèrent que la série est un projet mineur de Moore - les productions ensanglantées de l'éditeur Avatar n'étant pas toujours bien vues par la critique - il suffit d'une seule image de « Providence, tome 2 : L'Abîme du Temps » pour les faire démentir. Cette image, c'est le tableau « The Police Strike: A Settlement » qui ferme le troisième chapitre et que l'auteur décrit comme ''la case la plus chère de l'histoire du comics''. Et pour cause, ce tableau présentant un policier dévoré par des goules est en fait une photographie conçue avec Mitch Jenkins et la costumière Susanna Peretz (deux collaborateurs réguliers de Moore sur ses productions plus ''théâtrales''). Preuve, s'il en est, que les auteurs n'ont pas peur de sortir des sentiers battus pour améliorer l'expérience de lecture (il eût été bien plus simple et logique que Jacen Burrows dessine le tableau par exemple, surtout pour une apparition unique). Dans le chapitre suivant, patchwork de récits et de narrations entremêlés, Alan Moore offre la clé du monde des rêves, thème maintes fois exploré par l'auteur, pour cartographier les différentes strates qui le composent. Pour ce faire, la thématique s'y prête, le sorcier de Northampton vampirise gentiment un autre auteur d’un Art bien différent : Windsor McCay. Pendant quelques pages, l'auteur transforme la série Providence en une sorte de ''Little Nemo horrifique'' où Black explore le rêve avant de s'éveiller dans la chute (littéralement). Si l'allusion à ce chef-d'œuvre de la bande-dessinée semble sortir de nulle part, notons que Moore travaille sur la web-série interactive « Big Nemo », avec sa collaboratrice Colleen Doran, à l'époque où il rédige Providence. Ce segment prouve aussi qu'Alan Moore tisse sa toile bien au-delà de l'œuvre de Lovecraft pour mieux en dégager les aspects dérangeants (Black chute du mauvais côté, vers les Entités Extérieurs). En avançant, Black apprend que le livre des étoiles sur lequel il enquête prophétise l'arrivée d'un antéchrist. L'idée d'un destructeur-élu chez Moore n'est pas nouvelle non plus. À ceci près que, si on jette un coup d'œil à ses prédécesseurs, notamment « Prométhéa » ou Harry Potter dans « La Ligue des Gentlemans Extraordinaires : Century », on s'aperçoit que ces anti-messies ne se concrétisent jamais comme de véritables destructeurs mais plutôt comme une étape ; une apocalypse dans son sens premiers du ''dévoilement'' (bonne dans le cas de Prométhéa, mauvaise dans celui du jeune sorcier balafré). Bref, ils représentent un début plutôt qu'une fin. Sachant cela, on ose à peine imaginer ce qui attend Robert Black dont la destination finale nous est bien connue. Providence est le nom de la ville dans laquelle vécut H.P. Lovecraft mais définit aussi une personne où un événement qui arrive à point nommé. Reste à savoir pour qui et dans quel but. En Bref : Conséquence de l'analyse pointue du corpus Lovecraftien qu'entreprend Alan Moore, Providence se révèle être une enquête riche aux indices multiples. Le développement du récit dans ses infimes détails appelle déjà une relecture minutieuse du tome précédent, en attendant ardemment la conclusion de la série. Graphiquement, le style ''raide'' de Jacen Burrows répond aux attentes du récit. Ses personnages en piquet ont du mal à se concrétiser dans l'espace, signe de la bienséance d'époque qui veut que personne ne s'excite trop ; et l'in-expression ambiante supplantent les rares moments de joies et contrebalancent l'horreur qui se lit souvent sur le visage des protagonistes. Un style rigide (même dans sa mise en scène aux bandes régulières), ordinaire, qui s'accommode justement à une horreur qui se cache sous les strates du réel. Ftaghn You !
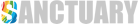







Laissez un commentaire
Commentaires (0)