Viens Dans Mon Comic Strip : Testament pour l’humanité
Jim s'attarde sur une nouvelle oeuvre de Jim Starlin !

Testament pour l’humanité

« Gilgamesh II ? Purée, je vais rien comprendre, j’ai pas lu le premier ! » Voilà une blague qui me fait bien rire et qui fonctionne toujours, vous pouvez la faire avec Gen13, Fantastic Four, Apollo 13 (ou 18) ou Maroon 5. Sauf que dans le cas de la série de Jim Starlin, c’est pas si idiot que ça. Plus que suite proprement dite, c’est une réécriture, dans un contexte de science-fiction, du plus ancien texte écrit humain.

En bon petit inculte que je suis, je crois ne m’être intéressé au premier Gilgamesh que parce Jim Starlin, sans doute l’un de mes auteurs favoris du monde entier de tous les temps, en avait donné une interprétation que j’ai mis des années à dénicher. Un peu de contexte s’impose.

Personnage mythologique ancestral, Gilgamesh est le héros de l’épopée portant son nom. Du temps lointain de mes folles études de lettes (A, B, C…), l’Épopée de Gilgamesh m’avait été présentée comme le plus vieux texte humain encore conservé. Aujourd’hui, on m’en parle comme l’un des plus vieux, ce qui donne une idée des progrès de la recherche. Bref. La première version du récit daterait (je balance les précautions d’usage car je ne suis vraiment pas dans mon élément, l’ami Nikolavitch passera bien dans le coin pour éclairer nos lanternes de sa sagacité…) du huitième ou septième siècle avant Jésus-Christ, ce qui, de toute façon, est bien lointain.

Le récit, en soi, est assez connu : Gilgamesh est puissant et ambitieux (le thème du péché d’orgueil attisant le courroux des dieux est présent), mais seul. Il rencontre Enkidu, qui s’avère être son double (à tous les sens du terme : jumeau mais aussi reflet). Ensemble, ils vivent de nombreuses aventures mais Enkidu meurt. Ce décès confronte Gilgamesh à l’échec et au vide mais, ambitieux comme il est, il part en quête du secret de la vie et de l’immortalité, bien décidé à vaincre la mort. Bien entendu, ce n’est pas vous gâcher la surprise que de vous dire qu’il va se planter, faisant l’expérience de l’échec, de l’humilité et de l’oubli. Grandeur et décadence, tout ça tout ça…

Pour ceux qui connaissent un peu le travail de Jim Starlin (ou a déjà parlé de lui en évoquant sa formidable Metamorphosis Odyssey), les thèmes de la mort et de l’hubris ne pouvaient qu’attirer l’auteur. C’est ainsi qu’il se retrouve, en 1987, chez DC Comics, pour qui il a déjà travaillé à de nombreuses reprises et chez qui il va laisser quelques jalons de premier ordre (Batman: The Cult, Cosmic Odyssey, la mort de Robin…), occupant une place de choix dans l’écurie de l’éditeur.

Son Gilgamesh II n’est pas une suite. C’est plutôt une sorte de remake, placé dans un univers de science-fiction divergeant de notre histoire à partir du début des années 1992. Programme ambitieux pour l’auteur qui, factuellement, se confronte aux deux grands ennemis de son héros (mais aussi de tout écrivain), à savoir la mort et l’oubli. Pour cette aventure éditoriale, il est accompagné des responsables éditoriaux Denny O’Neil et Dan Raspler, du coloriste Steve Oliff (qui travaille en traditionnel mais dans une palette lumineuse et douce qu’il explorera à l’informatique dans la version américain d’Akira) et du lettreur Todd Klein (dont les bulles et les onomatopées témoignent d’un soin séduisant). Autant dire que c’est une équipe de premier ordre qui l’accompagne.

Le récit est publié sous la forme de quatre « prestige format », ces comic books de quarante-huit pages, à dos carré et sans publicité, qui, depuis le Dark Knight Returns, constituaient l’annonce de l’ambition de l’éditeur et de la qualité du produit à l’intérieur. C’est d’ailleurs tout à l’honneur de DC Comics de publier un récit indépendant déconnecté des univers de super-héros. L’existence, au catalogue de l’éditeur, de titres comme le Ronin de Miller ou le Gilgamesh II de Starlin (voire du Nathaniel Dusk de Don McGregor et Gene Colan, et quelques autres…) fait partie des signes annonciateurs, des initiatives éditoriales ouvrant la voie, plus tard, au label Vertigo.

Starlin, qui vient de passer quelque temps dans le studio des Upstart Associates, a fréquenté assidûment Howard Chaykin et Walt Simonson, qu’il connaît depuis longtemps, mais également Frank Miller. Nous avons déjà remarqué, en évoquant Batman: The Cult, que Starlin (avec Wrightson) reprenait avec une aisance confinant au plagiat la narration de Miller. On aura aussi repéré le jeune Miller parmi les personnages de Metamorphosis Odyssey. L’amitié entre les deux hommes semble bien enracinée, et les parentés stylistiques apparaissent dès lors comme un hommage, ou une influence croisée. Deux détails laissent transparaître l’influence de Miller. D’une part, la série est supervisée par Denny O’Neil, responsable éditorial des Daredevil de Miller, qui l’appellera sur Batman: Year One, à une période où la série Batman sera ensuite confiée à Starlin. Sachant que Starlin a jusque-là travaillé surtout avec Roy Thomas, Archie Goodwin ou Len Wein, Miller aurait-il intercédé entre les deux hommes ? Autre fait marquant, l’apparition d’un dangereux ninja tout de noir vêtu, voué à la perte de Gilgamesh et… prénommé Frank. Hommage au compagnon de route professionnelle ? Starlin utilise la forme en aplats noirs du ninja avec roublardise et dynamisme, marchant sur les brisées de Miller. Le clin d’œil est clair, d’autant que l’utilisation de cases horizontales en vue de restituer les affrontements rapproche les deux auteurs et les place dans la lignée d’une influence commune, celle de Steve Ditko.

S’il est un autre parallèle à chercher entre Starlin et Miller, c’est dans l’univers futuriste décrit, une société dystopique, un lendemain qui déchante. Le monde mis en scène par Starlin évoque l’avenir sombre et douloureux de Give Me Liberty, avec quoi il partage de nombreux points communs. Le drame écologique en Amazonie annonce les déforestations violentes dans le sillage des armées à la solde de compagnie de fast-food dans l’œuvre que Miller et Gibbons publieront chez Dark Horse quelques années plus tard. La « guerre des corporations » montrée par Starlin correspond à la privatisation du pouvoir politique dont Miller et Gibbons font l’agent de dissolution de leur Amérique de cauchemar. Les deux récits partagent, en sus, un humour caustique et grotesque, une satire sociale parfois voisinant le mauvais goût avec un sourire de garnement. Le premier numéro présente un cours d’histoire permettant aux lecteurs de se tenir au courant. Le cours est donné par un enseignant robot aux allures de Monsieur Loyal faisant des claquettes. Starlin fait le portrait d’une nouvelle génération inculte et illettrée. Autre portrait saisissant, celui des pouvoirs politiques, bataillant pour des absurdités comme les licences de taxi accordées aux aveugles afin de lutter contre une discrimination faite aux non-voyants. Entre grand-guignol et théâtre de l’absurde, Starlin envoie des piques violentes au monde contemporain, veine humoristique à laquelle il reviendra dans certains de ses épisodes de Silver Surfer.

La narration de Starlin, dense, articulée autour de petites cases et de nombreux plans rapprochés, et faisant un grand usage des voix off, des commentaires dans les marges et des bulles ouvertes sur les intercases, n’est bien entendu pas sans rappeler celle de Miller sur Dark Knight Returns, à qui il emprunte même quelques cases en écran télé. La proximité des deux styles (et des deux hommes) explique sans doute avec quelle sincérité il a su singer cette approche à l’occasion de The Cult.

Au centre de cet univers où tout est légalisé et marchandisé (prostitution, drogue…), et où règnent des décisionnaires âpres au gain et des journalistes qui déforment la vérité, Starlin place un héros surhumain dont la différence fait de lui l’homme providentiel. Là encore, l’auteur fait preuve d’un humour discret mais ravageur. Les origines du héros renvoient à Superman : comme le Kryptonien, Gilgamesh a été placé dans un berceau spatial qui s’est écrasé sur Terre. Le vaisseau de ses compatriotes contenait des survivants d’un monde déjà perdu, et face aux avaries irréparables, le capitaine a ordonné que deux enfants soient envoyés sur Terre afin de préserver l’espèce. Sauf que cet idiot de robot a envoyé… deux mâles. Ça commence bien. Recueilli par des hippies cultivant et commercialisant le cannabis, le bambin de l’espace est baptisé par sa mère, qui se rappelle modérément ses cours de littérature. Confondant les légendes, elle se souvient de celle de Beowulf et appelle le bébé adopté… Gilgamesh. On apprend quelques cases plus loin qu’il a échappé à « Bullwinkle ».

Homme providentiel issu des « guerres des corporations » que Starlin dépeint comme des batailles homériques sans fin, Gilgamesh fait preuve d’ambition. Cependant, ce n’est pas au courroux des dieux qu’il se frotte, mais à celui des grands groupes financiers ayant remplacé les États-nations. Le dieu unique, c’est le dollar, à qui seul on dresse des statues. Et si l’on baptise des places du nom de Reagan ou de Bush, Gilgamesh occupe le rôle de « Chairman », ce qui n’est pas sans évoquer la désignation de Mao : Starlin renvoie dos à dos le libéralisme sans garde-fou et le communisme d’État, à qui le premier emprunte le contrôle de l’opinion publique et la réécriture de l’histoire officielle.

Rencontrant son Enkidu, baptisé ici Otto, Gilgamesh découvre enfin qu’il n’est pas seul. Ensemble, ils affrontent le monstre (deuxième partie), puis le tueur (troisième partie), avant que Gilgamesh, puisant son inspiration dans les évocations fumeuses de la drogue, ne parte en quête de l’immortalité, désespéré à l’idée de pouvoir vaincre la mort et faire renaître Otto. Sa route l’enverra sur le site d’une catastrophe scientifique présentée dans le premier épisode, et, par le truchement d’un paradoxe temporel, il découvrira que son maigre pouvoir lui aura été arraché par un destin contraire. Dépouillé de tout (au propre comme au figuré), il ne se rendra pas compte que même son nom sera oublié de la postérité.

Formellement, Starlin, qui s’essaie à la caricature visuelle et témoigne de l’influence de la bande dessinée franco-belge de science-fiction de l’époque (les costumes et les décors sentent bon leur Moebius ou leur Bilal première manière), est un cran en dessous de ce qu’il a livré pour La Mort de Captain Marvel, sans doute ses planches les plus abouties à ce jour. Si le dessin montre quelques faiblesses, Starlin en maîtrise les moindres aspects, signant un encrage sec et à l’économie. L’émotion et la force évocatrice du dernier chapitre, d’une grande intensité, n’en sont que renforcées.

Chose étonnante que ce Gilgamesh II. Sorte de testament prématuré de Starlin, qui s’interroge sur l’ambition artistique et sur la postérité (deux thèmes liés à celui de la mort), il demeure une œuvre un peu éclipsée par des récits aussi marquants que La Mort de Captain Marvel. Starlin est-il comme son Gilgamesh, seul, dénudé, occulté à jamais dans les ornières de l’histoire ?
Jean-Marc Lainé, auteur, traducteur et responsable éditorial dans le monde des comics. Il a écrit récemment le livre : Comics & Contre-Culture, disponible à ce jour.
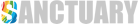




Commentaires (0)